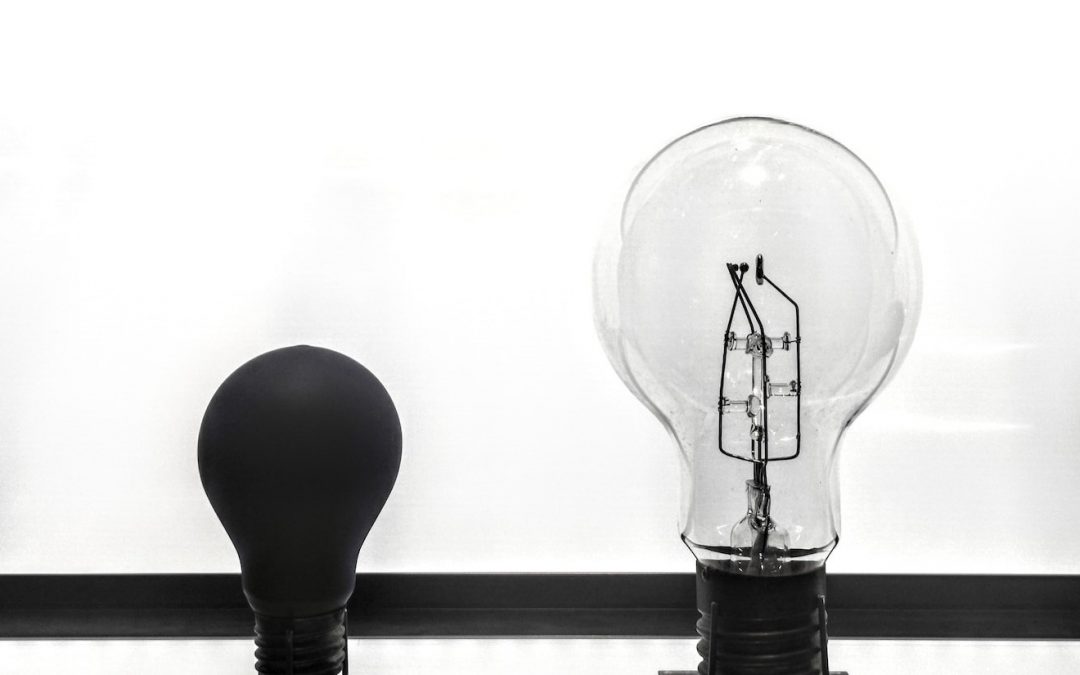Qu’est-ce que l’originalité ?
Définition du concept
L’originalité qualifie quelque chose d’original, comme un procédé, une œuvre, un concept… Ce mot fait opposition aux termes de banalité ou bien de la notion de copie, ce qui est dû à ses multiples sens. La plupart du temps, on utilise ce terme de façon positive, mais il peut aussi être interprété comme négatif.
Sens multiples
Le terme d’originalité a plusieurs sens, et c’est pour ça qu’il semble indispensable de les définir.
- L’originalité peut définir une œuvre marquée du style, de la personnalité et de la créativité de son auteur. C’est le sens qui s’oppose à la copie et aux contrefaçons.
- Dans la même idée, une œuvre dite originale est aussi dite protégée par des droits d’auteur.
- Un élément original peut aussi être une nouveauté, sans précédent, unique, créatif, neuf (à noter qu’une œuvre peut être originale sans forcément être nouvelle).
- Et enfin, nous pouvons parfois utiliser ce terme en tant qu’euphémisme pour qualifier quelqu’un d’excentrique ou quelque chose de bizarre.
Pourquoi l’originalité est-elle aussi recherchée ?
Mais alors, pourquoi l’originalité est-elle aussi convoitée dans ses sens positifs ? En effet, beaucoup de domaines sont si “compétitifs” que l’on se doit de se démarquer parmi les autres, soit pour trouver un poste, toucher une audience, créer une communauté, etc.
Dans l’art
Un de ces domaines auquel on peut penser est le domaine de l’art. Ici, on pourra se questionner sur la première définition de l’originalité en général : celle de la perception de l’auteur, son style, sa “signature”. En effet, le monde créatif demande sans cesse aux créateurs de faire preuve d’originalité à travers leurs œuvres, en espérant pouvoir gagner le cœur d’un public.
Chaque artiste ou créateur doit sortir du lot, montrer quelque chose de jamais vu ou encore être admiré par les critiques. Nous pouvons parler de l’histoire de Han van Meegeren, un peintre néerlandais, qui avait pour objectif d’être salué par la critique d’art. Ne pouvant se démarquer malgré sa technique exceptionnelle, il décide de changer de style et de s’inspirer de l’âge d’or néerlandais. Cependant, malgré ses efforts, Han van Meegeren sera considéré comme un artiste faisant des “imitations fatiguées de vraies œuvres”, ce qui amènera le peintre à duper les critiques d’arts en leur faisant certifier “originales” des fausses copies des tableaux du célèbre peintre Vermeer.
Paradoxalement, il existe de nombreuses œuvres qui ne sont pas “neuves” mais qui connaissent beaucoup plus de succès que lesdites “originales”. Par exemple, de nombreuses histoires Disney telles que La Belle au Bois Dormant, Blanche Neige et les sept Nains ou encore Cendrillon ne sont qu’une interprétation différente des contes vus par les frères Grimm, Charles Perrault ou Giambattista Basile, qui pouvaient contenir des scènes assez violentes, heureusement omises par Disney.
Ainsi, l’originalité d’une œuvre ne dépend-elle-elle pas plutôt du regard de son public ?
Dans le monde du travail et du marketing
Parallèlement, le monde du travail et du marketing (notamment du personal branding) a aussi son côté très compétitif où même le bad buzz (réaction violente et négative d’une communauté envers une marque) peut faire partie d’une stratégie marketing. Certaines marques vont donc jusqu’à traiter de sujets comme le féminisme, l’écologisme, la justice, l’égalité pour susciter de l’intérêt, même négatif.
Par exemple, l’opérateur Numéricable a publié un visuel provocateur : “Téléchargez aussi vite que votre femme change d’avis”, mentionnait-il. Suite à quoi il crée un “correctif” d’autant plus sexiste : “Téléchargez aussi vite que votre mari oublie ses promesses”. Et finalement, la marque a gagné en visibilité. Jusqu’où les marques pourront-elles aller pour faire preuve d’originalité ?
Du côté du personal branding et du marketing plus vertueux, une des premières choses que l’on apprend est l’importance d’avoir une image très propre et très professionnelle, mais aussi très originale. Interflora, une marque de transmission florale, a par exemple une manière très spécifique de communiquer sur les réseaux sociaux : champ lexical de l’amour, un ton doux, des emojis coeurs à tout va… La marque a su se démarquer et créer une stratégie qui lui est propre, ce qui permet à n’importe qui de la reconnaître en un seul coup d’œil. En effet, même le géant Mcdonald’s a aujourd’hui recours à des publicités visuelles composées uniquement d’un gros plan de frites—à l’instar de Coca-Cola, la présence et signature de la marque sont si fortes qu’il n’est même plus nécessaire de communiquer pour de la visibilité.
C’est donc ici que commence une guerre de la marque ou de la personnalité la plus originale, de celle qui saura le plus innover. On peut également penser au Président de la République Emmanuel Macron qui s’est associé aux célèbres Youtubers McFly et Carlito pour un concours d’anecdotes à l’Elysée, dans le but d’améliorer sa popularité auprès des jeunes.
En parlant de personal branding, il fonctionne comme une marque : aujourd’hui, pour trouver un emploi, il faut avoir le CV le plus original, susciter de l’intérêt sur le réseau social LinkedIn avec des posts, des commentaires pertinents… Vidéos, créations 3D, motion design sont au rendez-vous. Il suffit de taper “CV original” sur Google pour voir l’abondance de réponses. Il existe même des pages et groupes faisant hommage à toutes ces personnes créatives à la recherche d’un emploi, où l’on peut remarquer que beaucoup s’inspirent de grandes marques telles que Netflix, Spotify, Macdonald’s, etc.
Finalement, à force de vouloir être original, ne nageons-nous pas à contre-courant ?
Pourquoi l’originalité est-elle un concept peu fiable ?
Le regard subjectif du public
Dans les exemples vus dans l’univers de l’art, nous pouvons remarquer qu’une œuvre d’art prend donc toute son originalité (et en l’occurrence, son succès) selon le regard et l’écoute de son public. C’est un concept qui s’est confirmé lorsque Marcel Duchamp exposait un simple urinoir baptisé Fontaine dans un musée. Il a bel et bien démontré qu’au final, quel que soit l’investissement de l’artiste, l’originalité est toujours accordée (ou non) par le regard subjectif du public.
Tout le monde veut être original
Dans toutes ses définitions, l’originalité se base sur le concept de rareté. Plus quelque chose est rare, plus il est précieux—et paradoxalement, tout le monde recherche l’originalité. En tant qu’employeur à la recherche d’une perle rare, comment est-il possible de faire le meilleur choix quand le marché du travail est saturé de demandes toutes aussi “créatives et originales” ?
Pourtant, il est difficile de ne pas tomber dans le piège du surplus d’informations ou d’une forme qui oublie le fond. L’architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe disait “Less is more” (moins, c’est plus), qui devint rapidement le paradigme du design moderne. En effet, ne devrions-nous pas plutôt retourner à l’essentiel dans cette guerre de l’originalité, et en ce cas, redorer ses valeurs ?
L’adage “tous pareil, tous différents” ne s’est jamais avéré aussi exact : nous sommes tous uniques, tous originaux à notre façon, et nous sommes aussi tous pareils, car à la recherche de la précieuse originalité.
Finalement, l’originalité n’est-elle pas régie par ce qui a déjà été fait ?
Les attaches de l’originalité
Toute œuvre ou création a forcément besoin d’attaches, de bases, de règles pour être cohérente. Au cours de l’histoire, de nombreuses techniques ont été développées, se basant sur d’autres formes. Par exemple, lors de l’écriture d’un roman, nous pouvons reconnaître la plupart des schémas narratifs, car déjà développés. Ces schémas et techniques établissent un cadre dans lequel l’auteur laisse libre cours à sa créativité à travers son interprétation et son style d’écriture.
D’une même idée, tout artiste ou créateur a des inspirations, des muses, des références ou hommages, et considérons-nous quand même leurs œuvres et contenus non originaux ? J. R. R. Tolkien, créateur de l’univers du Seigneur des Anneaux a pioché dans les légendes et la mythologie scandinave pour créer son œuvre à succès. Parallèlement, George Lucas, créateur de Star Wars, s’est inspiré des travaux du mythologue américain Joseph Campbell sur les origines des mythes et des religions.
Il semble donc impossible de créer à partir de rien. Selon le romancier québécois Jean-Yves Soucy, “impossible de partir de rien ; pour créer il faut d’abord détruire ce qui est, puis bâtir avec des débris.”
Être “trop” original
À vouloir être “trop” original, on a donc tendance à oublier les attaches et le cadre de repère. C’est pour cela qu’il existe de nombreux exemples de concepts dits trop en avance sur leur temps, comme le casque virtuel de 1995, le Virtual Boy, par le géant du jeu vidéo Nintendo. Dans sa guerre frénétique des consoles contre Sega, Nintendo met au point une console portable qui connaît un cuisant échec, forçant l’entreprise à arrêter la commercialisation de son casque moins d’un an après sa sortie. Les raisons de cet échec ? Un accessoire mal pensé, pas vraiment portable, des graphismes monochromes rouges, prix trop élevé… Mais surtout trop en avance sur son temps, trop innovant.
Effectivement, près de 30 ans plus tard, les casques de réalité virtuelle sont très populaires et suscitent énormément d’intérêt tant ils sont le futur du jeu vidéo.
Conclusion : Le cycle de l’originalité
Un peu comme un effet de mode, l’originalité est peut-être vouée à être constamment renouvelée, ce qui est totalement contraire à sa définition-même. En littérature, par exemple, la plupart des classiques se basent sur des textes plus anciens, et ainsi de suite. On peut ainsi se douter de la provenance et des inspirations des futures créations.
Au final, cet effet peut se comprendre : le cerveau humain apprécie le sentiment de familiarité. C’est comme écouter une même chanson en boucle—c’est rassurant, on peut l’anticiper, la chanter, et avoir l’impression de participer activement à sa création, d’où l’importance de garder des règles et des repères que tout le monde connaît déjà (et bien évidemment, le côté fonctionnel). Ce n’est pas un hasard si de nombreux spots publicitaires utilisent l’air d’une chanson déjà connue pour nous chanter leurs messages ou que les samples de musique sont utilisés encore et encore dans les nouvelles chansons d’aujourd’hui.
Ainsi, l’originalité telle que nous l’interprétons est toujours appréciable, mais elle ne devrait peut-être pas être un but final, de par sa nature subjective et peu fiable en tant que dogme.
Comment écrire un roman ?
Pourquoi écrire un roman ? S'inspirer avant d'écrire Noter ses idées Lire d'autres histoires...
Le SXO, nouveau référencement : Comment le SEO et l’UX se combinent
Pour un peu que vous suivez les actualités SEO, vous avez dû entendre parler du SXO. Acronyme de...
Défi du dessin : 5 challenges du dessin sur le Web
Si vous suivez quelques artistes sur les réseaux sociaux Instagram ou Pinterest, vous avez...
Développer sa créativité : 5 conseils pour débuter
La créativité, voilà une compétence que l’on pourrait souvent vous demander lorsque vous vous...